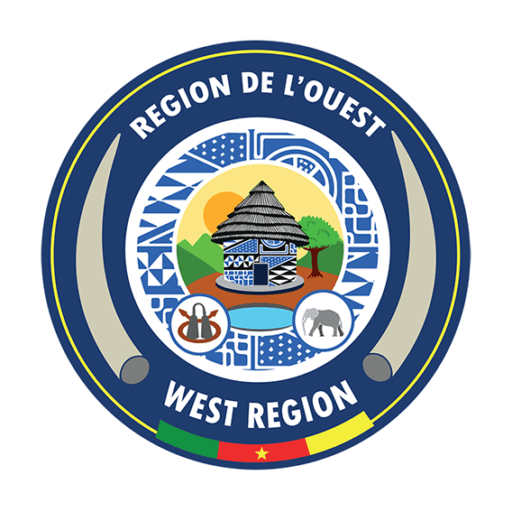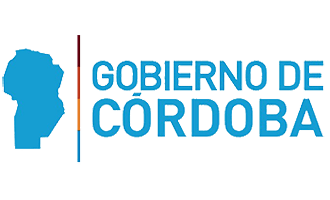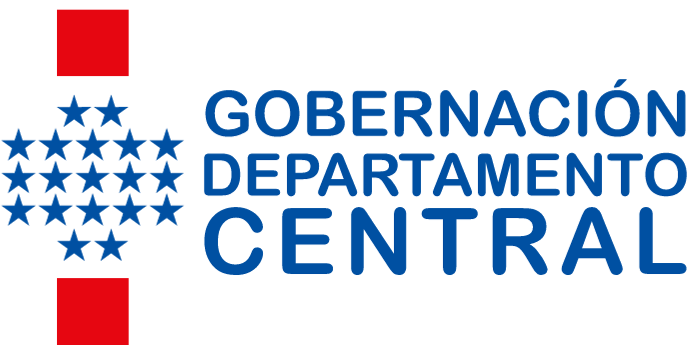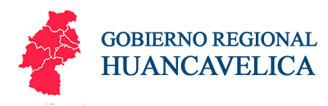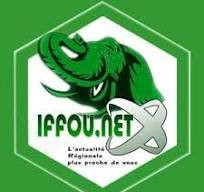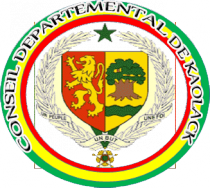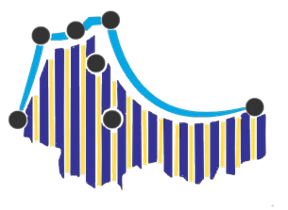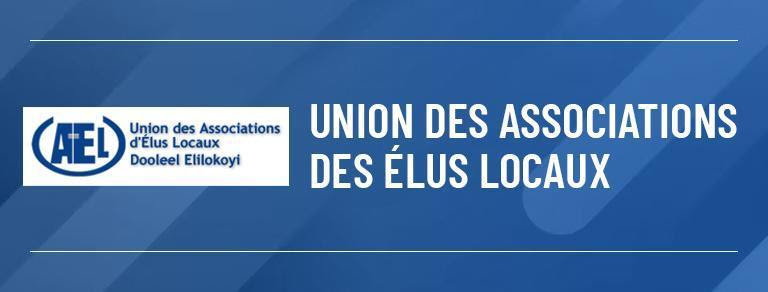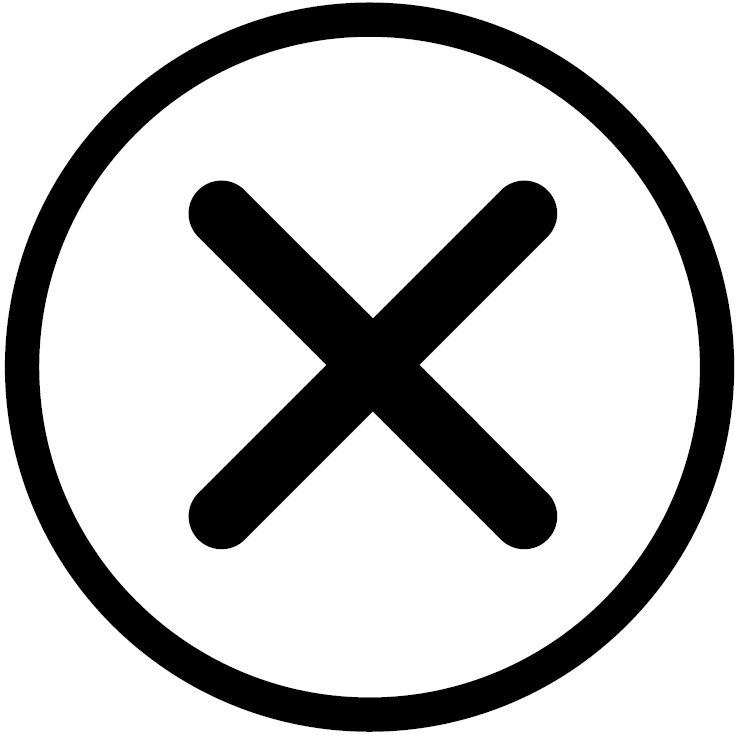Le CFS 53 prévient que l’objectif de développement durable « Faim zéro » ne sera pas atteint avant 2030

Le monde reste encore loin du deuxième Objectif de développement durable, « Faim Zéro ». C’est le principal avertissement qui a présidé à l’ouverture de la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CFS53), qui s’est tenue du 20 au 24 octobre au siège de la FAO, à Rome. Malgré des années d’engagements et de promesses, le nouveau rapport SOFI 2025 - The State of Food Security and Nutrition in the World - confirme que près de 630 millions de personnes souffrent de faim chronique. Cela représente une légère diminution de la faim dans le monde, passant de 8,7 % à 8,2 % de la population mondiale. Cependant, malgré ces chiffres, plus de 23 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à une alimentation adéquate. Cette situation crée une tendance inquiétante. Le coût d'une alimentation saine a augmenté de plus de 30 % depuis 2020. Les conflits armés, la crise climatique et la stagnation économique ont mis à rude épreuve les systèmes alimentaires les plus vulnérables.
Comme l’a résumé Beth Bechdol, directrice générale adjointe de la FAO : « Sans un changement radical dans la façon dont nous produisons, distribuons et consommons les aliments, le monde n’atteindra pas l’ODD 2. La faim n’est pas inévitable : c’est une question prioritaire sur le plan politique. »
Le CFS est l'espace intergouvernemental de référence sur la sécurité alimentaire au sein du système des Nations Unies. Lors de sa 53e session, ministres, agences de l'ONU, organisations telles que l'ORU Fogar, représentants des secteurs public et privé se sont réunis. Le slogan de cette année est : Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, l’objectif était de souligner la nécessité de passer des déclarations aux actes. Le débat s’est articulé autour de quatre axes principaux : les systèmes alimentaires urbains et périurbains, le financement responsable, la résilience face aux crises et l’importance de maintenir la pression politique sur la nutrition après 2030. Le tout avec un objectif clair : trouver des moyens concrets d’accélérer la transformation des systèmes alimentaires dans un contexte de stagnation mondiale.
L'un des points saillants de cette édition réside dans l'importance croissante accordée aux villes et aux régions. Le document de recommandations sur les systèmes alimentaires reconnaît que les politiques alimentaires ne peuvent plus se limiter au niveau national. Pour la première fois, le CFS aborde explicitement la question de la gouvernance multiniveaux, plaidant pour une coordination entre les gouvernements nationaux, régionaux et locaux afin de garantir la cohérence des politiques alimentaires. Les recommandations préconisent de soutenir les stratégies territoriales qui relient la production rurale, la distribution régionale et la consommation urbaine, ainsi que de renforcer les plans d'alimentation urbaine selon des critères de proximité, de durabilité et de santé publique. Cette vision rejoint les pratiques déjà mises en œuvre dans de nombreuses régions du monde, de l'Europe à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique : marchés locaux, programmes de nutrition scolaire, circuits courts et politiques régionales pour une alimentation saine. « L'avenir de la nutrition ne s'écrit pas seulement dans les ministères, mais aussi dans les villes et les territoires », a souligné le représentant du Comité européen pour les régions lors d'une session.
Le débat sur le financement des systèmes alimentaires durables était également central. Le CFS 53 a souligné que la lutte contre la faim est indissociable du débat sur le capital : où est-il investi, selon quels critères et avec quels résultats ? Les recommandations insistent sur le fait que le financement de l’agriculture et de l’alimentation doit privilégier la nutrition, la justice sociale et l’action climatique, et non le seul profit économique. Parmi les points saillants, on note l’appel à mobiliser les banques régionales de développement et les mécanismes de financement infranationaux. Il est confirmé que les collectivités locales et régionales peuvent constituer des plateformes efficaces pour orienter les ressources vers des projets agroalimentaires durables, les petits producteurs ou les initiatives d’économie circulaire.
Ces dernières années ont démontré que les crises alimentaires ne sont pas des phénomènes isolés, mais des manifestations récurrentes de vulnérabilités structurelles. Le CFS 53, lors de ses débats sur la résilience alimentaire, a reconnu que la proposition devait aller au-delà de l'aide d'urgence. Il a été proposé de renforcer les capacités territoriales à anticiper et à contrer les chocs – climatiques, économiques ou politiques – et à réduire la dépendance extérieure qui accroît la fragilité des systèmes alimentaires. Les résolutions sur la résilience visent à donner aux gouvernements régionaux et locaux les moyens d'élaborer leurs propres stratégies, adaptées à leur contexte. Dans les zones touchées par les conflits ou le changement climatique, la proximité de la gestion peut faire la différence entre la résistance et l'effondrement.
L'ORU Fogar était représentée à la 53e CFS par son secrétaire général, Carles Llorens, qui a tenu plusieurs réunions techniques afin d'établir des axes de coopération avec la FAO et d'autres organisations participantes. Lors de ces réunions, il s'est particulièrement intéressé aux possibilités de poursuivre la collaboration avec les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur les questions de sécurité alimentaire et de pauvreté rurale. Au cours d'une de ces réunions, Corinna Hawkes, directrice de la Division des systèmes agroalimentaires et de sécurité alimentaire, et Llorens ont identifié de nouvelles opportunités d'exploitation des dynamiques de la FAO en faveur des femmes, des jeunes et du monde rural, trois domaines qui figurent parmi les recommandations adoptées lors de cette session.
La participation de l’ORU Fogar a renforcé l’idée que les régions peuvent être des acteurs stratégiques de la transformation alimentaire, un message qui gagne du terrain au sein du système des Nations Unies. Lors de sa rencontre avec la présidente du CFS, l’ambassadrice Nosipho Nausca-Jean Jezile a assuré au secrétaire général de l’ORU Fogar que les recommandations du Comité placent les territoires et les régions au cœur de la solution.
L'une des questions les plus débattues était, en tout état de cause, de savoir comment garantir que les recommandations du CFS ne restent pas lettre morte. Le Comité a élaboré un nouveau plan d'action visant à renforcer l'application territoriale des politiques, assorti d'un contrôle à plusieurs niveaux. Ce plan comprendrait notamment des plateformes de coopération régionale, où les collectivités territoriales, les réseaux de villes et les organisations internationales pourraient partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques. Des organisations telles que l'ORU Fogar pourraient jouer un rôle clé dans ce processus, en facilitant le dialogue entre les territoires et le système des Nations Unies.
Malgré le tableau sombre que dresse le SOFI 2025, le CFS 53 a également été un espace d'optimisme pragmatique. Un consensus général se dégage quant à l'existence de solutions, mais de nouvelles alliances et une action gouvernementale cohérente restent indispensables. La transformation du système alimentaire ne peut plus attendre. Comme l'a résumé l'un des intervenants lors de la session de clôture : « L'avenir de la sécurité alimentaire se construit sur le territoire. Ce n'est qu'en donnant les moyens aux communautés, aux régions et aux villes que nous pourrons enrayer la faim et garantir le droit à l'alimentation pour tous. »